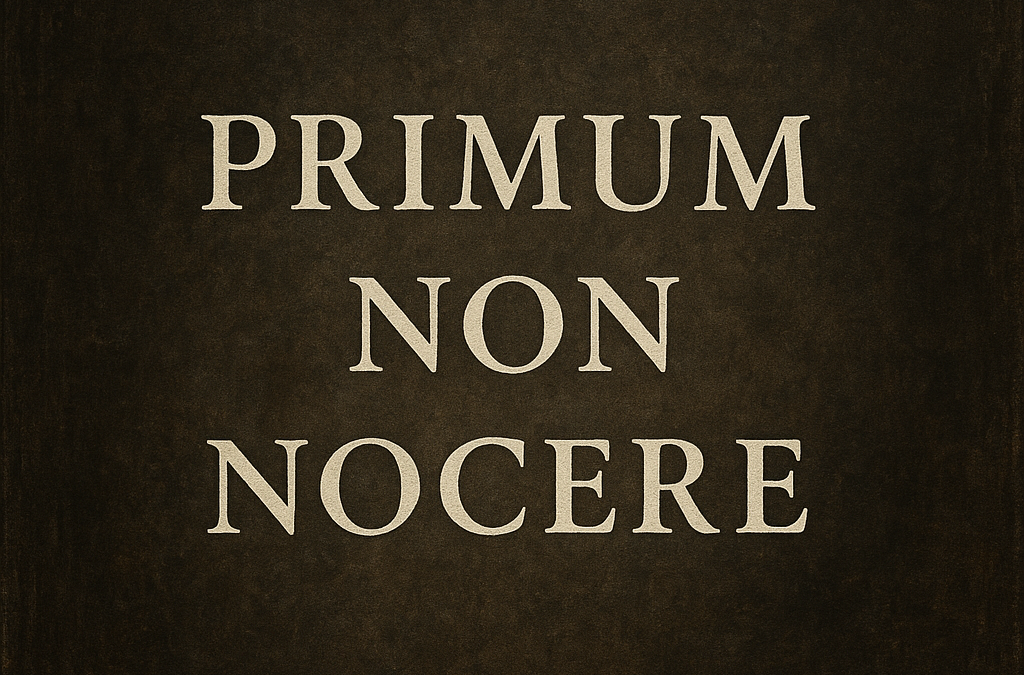On commence toujours par cette question simple et terrible : comment ne pas nuire ? (primum non nocere)
Non pas comment guérir — la guérison appartient aux dieux, à la chimie, à la contingence ou au roman intime du patient — mais comment ne pas détruire ce qui, en lui, tient encore debout lorsqu’il nous confie le fil fragile de son transfert. Car il suffit d’un rien pour briser un sujet : un mot trop brillant, un silence trop plein, un signifiant lancé comme une pierre. Un rien, et voilà qu’une existence vacille parce que celui qui écoute a oublié qu’il occupait une place imaginaire saturée de pouvoir.
Freud l’avait vu : la médecine ne s’exerce jamais à jeun.
Elle baigne dans une atmosphère lourde d’attente, d’angoisse, de croyance. Tout geste médical manipule un transfert qui s’ignore — et l’ignorance de cette manipulation est précisément son danger. Quand un médecin ignore ce qu’il incarne déjà, il devient le serviteur aveugle de la suggestion qu’il commande. Alors tout protocole peut devenir poison. Tout savoir peut devenir arme. Tout acte peut devenir blessure.
On devrait presque interdire la médecine à quiconque n’a pas traversé, au moins une fois, le désert d’une psychanalyse. Non pour lui inculquer une morale, mais pour lui faire toucher l’enjeu : savoir soigner suppose de savoir ce que l’on représente — fantasmatiquement — pour celui qui souffre.
Or aujourd’hui, ce fil incandescent du transfert tombe dans le vide.
Quelque chose s’est effondré : notre verticalité libidinale.
Nous vivons dans un monde administré par des visages sans figure : dirigeants sans énigme, élites sans chair, maîtres sans ombre. Rien en eux n’attire, ne trouble, ne divise, ne met en mouvement. Ce ne sont plus des personnes, mais des interfaces. Des silhouettes managériales. Des écrans de veille.
La supposée autorité du savoir n’a plus de corps où se loger.
Lacan disait qu’on suppose au maître un savoir.
Mais que se passe-t-il lorsque le maître n’a plus de corps où loger ce savoir ?
Lorsqu’il ne reste que la coquille fonctionnelle d’un rôle, sans libido, sans style, sans faille ?
Il se passe que le transfert devient négatif.
On ne suit plus : on se méfie.
On ne désire plus : on dénonce.
On ne s’abandonne plus : on s’endurcit.
Le monde glisse alors vers une horizontalité paranoïaque : un territoire où chacun surveille chacun, où tout affect est suspect, où toute verticalité est ressentie comme une agression.
C’est dans ce paysage dépeuplé que la psychanalyse doit aujourd’hui retrouver sa voix — une voix qui ne soit ni berçante ni poétique à la manière d’un opium. La talking cure n’est pas une berceuse. Elle est une opération de plomberie profonde : déboucher ce qui stagne, déraciner ce qui s’enkyste, nettoyer les conduits invisibles où la pulsion tourne en rond depuis des années.
C’est un travail sale — et c’est pour cela qu’il est noble.
Parce qu’il se fait à l’endroit où aucune technique n’a prise : le réel de la pulsion.
Ce point âpre, têtu, où la symbolisation se casse les dents.
La psychanalyse ne pacifie pas :
elle affronte ce qui insiste.
Elle ne simplifie pas :
elle dénoue.
Elle n’organise pas :
elle laisse respirer.
Et c’est ici qu’apparaît un malentendu moderne : l’idée que la parole tuerait la chose.
Mais la chose, il n’y en a jamais eu.
Le mythe de l’objet originaire, de la scène première, de l’unité perdue — c’est de la théologie recyclée. Le réel n’a jamais eu de visage : voilà pourquoi nous parlons. Le mot ne tue rien : il témoigne seulement de l’impossible.
Il y a autant d’origines qu’il existe de sujets.
Toutes solitaires.
Toutes irréductibles.
Toutes politiques.
Car la psychanalyse refuse le mythe du Un.
Elle refuse l’Un père, l’Un peuple, l’Un discours, l’Un récit totalisant.
Elle produit du pluriel, de la faille, de la respiration.
Elle maintient le monde ouvert, donc habitable.
Lacan le savait : c’est chez les poètes qu’il faut apprendre ce que fait un sujet avec la langue.
Le poète n’écrit pas : il est écrit, parlé.
La lettre le mord, le creuse, l’arrache. Sa chair imaginaire se convertit en chair verbale. L’érotisme se déplace du corps à la coupure.
Mais notre époque, saturée d’images vides, produit une tout autre espèce : des poètes involontaires, dont le corps est devenu trop mince pour retenir la marque du signifiant. Ils ne vivent plus que dans une jouissance digitale, une spectralité sans chair.
Le signe ne les affecte plus ; il les traverse en courant d’air.
La psychanalyse ne les touche plus ; ils vivent dans l’aérophagie des flux.
Que faire, alors, pour celui qui écoute ?
Lacan disait : « se coltiner la misère du monde ».
C’est-à-dire ne pas se protéger de l’époque, mais s’y exposer.
Ne pas raffiner sa position : la risquer.
Ne pas être puriste : être poreux.
Ne pas être un théoricien : être un corps.
Car si le monde manque aujourd’hui de figures, alors c’est au psychanalyste d’en devenir une — non pas au sens héroïque, mais au sens d’une présence incarnée, opaque, affectable.
Un lieu où un sujet puisse à nouveau supposer un savoir qui ne soit pas algorithmique, mais désirant.
Un lieu où la parole retrouve sa puissance d’ouverture.
Un lieu où la blessure du langage devient passage plutôt que clôture.
C’est peut-être cela, aujourd’hui, la tâche politique de la psychanalyse :
rendre au sujet la possibilité d’être affecté —
et par là, la possibilité d’être en vie.
Thierry-Auguste Issachar