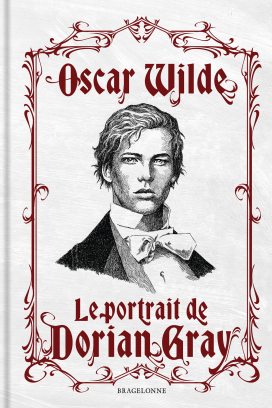Il est des moments où l’on croit que la modernité s’est libérée de toutes les anciennes croyances, mais il suffit de regarder comment elle se comporte face au temps pour comprendre qu’elle n’a jamais quitté l’animisme. L’animisme ancien ignorait toute séparation véritable : le désir rejoignait l’objet sans distance, la pensée touchait la réalité sans résistance, le moi et son double se confondaient dans un pacte silencieux. L’âme coulait dans le corps comme une eau non divisée. La toute-puissance y était la météorologie du monde intérieur.
Et pourtant, ces sociétés savaient organiser la coupure. Elles savaient initier. Elles savaient faire mourir l’enfant symboliquement pour que naisse le membre du clan. Elles savaient que la continuité de l’être exige la discontinuité du sujet. Elles savaient que l’on ne devient homme qu’en perdant quelque chose — un nom, un vêtement, une manière de respirer.
C’est ce savoir que nous avons oublié.
Freud en eut une intuition presque triviale, mais vertigineuse, dans un compartiment de train. Voyant entrer un vieil homme qu’il jugea d’abord antipathique, il comprit soudain que ce regard sévère, usé, étranger, était le sien propre — son reflet dans la vitre. L’effroi ne venait pas de la vieillesse en tant que telle, mais de cette rencontre brutale avec une image de soi qui n’avait pas été symboliquement intégrée. Le temps avait travaillé le corps, mais le sujet, lui, n’avait pas consenti à la perte de son image antérieure. Ce n’était pas la mort réelle qui surgissait là, mais l’horreur d’une mort symbolique non accomplie, revenue sous forme de double.
Cette scène minuscule dit tout : lorsque la perte n’est pas traversée, elle revient comme étrangeté inquiétante. Le sujet se surprend à ne plus se reconnaître dans ce qu’il est devenu, parce qu’il n’a jamais accepté de ne plus être ce qu’il fut.
Car notre époque, si prompte à se dire désenchantée, ne supporte plus la mort symbolique. Elle la confond avec la mort réelle. Elle croit que céder une place revient à s’effacer, que quitter une fonction revient à disparaître, que laisser tomber une image revient à être rayé du monde. Elle a perdu la logique de la substitution, celle par laquelle, dans Totem et Tabou, un père tombe pour que l’ordre symbolique se relève. Elle s’est détournée de l’idée freudienne selon laquelle le meurtre symbolique fonde la loi, et non l’inverse.
À cet égard, notre modernité ressemble étrangement à la fable de Dorian Gray. Le personnage ne vieillit pas ; son visage demeure intact, lisse, désirable. C’est ailleurs que le temps fait son œuvre — dans un portrait relégué, caché, nié, mais chargé de recevoir à sa place la marque du réel. Le pacte est clair : conserver l’image au prix du refoulement de la perte. Mais ce refoulement a un coût : plus le portrait se déforme, plus le sujet se vide. Ce qui devait mourir symboliquement — l’idéal narcissique, la jeunesse imaginaire, l’illusion d’un moi sans faille — est déplacé hors du champ du sujet, jusqu’à devenir monstrueux.
La modernité procède de la même manière. Elle conserve les corps dans des rôles comme on conserve Dorian dans son visage. Les fonctions ne vieillissent plus, les images ne tombent plus, les places ne se transmettent plus. Tout ce qui pourrait s’user est déplacé ailleurs — dans les objets, dans les machines, dans les statistiques — pendant que les figures humaines restent figées dans une jeunesse symbolique factice.
Dans cette atmosphère saturée de narcissisme blessé, la moindre déchéance imaginaire apparaît comme une catastrophe ontologique. Là où les sociétés premières instituaient des rites de mort psychique — dépouillement, retrait, traversée — nous avons créé des dispositifs qui maintiennent les individus dans une position de survivants à eux-mêmes, vivants biologiquement, mais empêchés de mourir à ce qu’ils furent.
Il est frappant, à cet égard, d’observer ce que Freud disait de la fin d’analyse : on ne guérit qu’en perdant quelque chose. Perdre une illusion, perdre une fiction de soi, perdre un idéal écrasant. L’analyse est ce travail de deuil précis, presque chirurgical, par lequel un sujet accepte que certaines images de lui-même cessent de le représenter. Lacan le radicalisera : devenir sujet, c’est tolérer la chute de l’image, la défaillance de l’Idéal, la désadhésion d’avec ce double imaginaire où l’on se croyait immortel.
Mais la modernité, elle, ne veut rien perdre.
Elle refuse la chute de l’image.
Elle refuse l’effacement du rôle.
Elle refuse la limite qui sépare l’être de la fonction.
Elle pense conjurer la mort réelle en refusant toute mort symbolique. Elle s’accroche aux positions comme Dorian à son visage, persuadée que céder serait mourir. Elle transforme la transmission en menace, la relève en offense, la vieillesse en scandale.
Freud avait pourtant montré que la transmission est, dans son essence, une pratique de la disparition. Dans le meurtre totémique — acte fondateur mais jamais historique — la horde consent à ce que quelque chose tombe pour que la loi se tienne. Sans meurtre symbolique, il n’y a ni loi, ni idéal, ni limite. Sans perte, tout s’effondre dans l’infini narcissique, où la seule mort pensable est la réelle.
Dans certaines formes de délire décrites par Lacan, l’Idéal devient si compact qu’il ne peut jamais tomber. Ce qui devrait symboliquement s’effondrer se maintient jusqu’à la catastrophe. On ne renonce plus à l’image ; on la défend jusqu’au meurtre ou à l’auto-punition. Là où la mort symbolique devrait faire son œuvre — dans la relève du père, dans la traversée du fantasme — quelque chose reste figé, collé à la première identification.
C’est cette incapacité contemporaine à mourir symboliquement qui produit les crispations du pouvoir, l’éternisation des positions, la peur d’être dépassé, l’impossibilité d’entrer dans l’après. Elle engendre une société où seul l’inerte vieillit : les objets s’usent, mais les images demeurent intactes ; les corps se fatiguent, mais les rôles persistent indéfiniment.
La psychanalyse, dans ce paysage, apparaît comme une survivance, presque une anomalie. Elle demeure la dernière discipline qui enseigne qu’il faut consentir à la perte. Qu’il faut laisser mourir quelque chose — un morceau de narcissisme, un idéal trop lourd, un savoir trop plein — pour qu’un sujet puisse advenir autrement.
Elle rappelle que l’adulte n’est pas celui qui a conservé son image intacte, mais celui qui a accepté d’en voir certaines se fissurer. Qu’il y a un temps pour tenir et un temps pour lâcher. Qu’il n’existe pas d’accès au symbolique sans renoncement à une part de soi.
Et qu’au fond, la seule maturité véritable consiste à reconnaître qu’il existe deux morts :
— la mort réelle, biologique, inévitable ;
— et la mort symbolique, civilisatrice, structurante, sans laquelle aucune vie humaine ne se soutient.
Freud, dans sa fine ironie, disait que la psychanalyse apprend à vivre sans magie. On pourrait ajouter : elle apprend aussi à vieillir sans effroi, et à mourir sans terreur.
Car celui qui accepte de mourir symboliquement n’est plus surpris par son reflet, ni hanté par son portrait. Il a déjà consenti à la seule mort qui transforme — celle qui libère le sujet de l’illusion d’être éternellement le même.
Thierry-Auguste Issachar